Les médias, comme objets et processus techniques, et conséquemment les médias comme institutions sociales, forment dans les moments successifs de l'anthropogénie des systèmes où ils sont en compensation réciproque. D'abord artisanaux, puis industriels, ils sont entretenus par l'intercérébralité intense des sociétés d'Homo.
Les média préindustriels, comme l'écriture, le dessin, la sculpture, la danse, voire l'architecture, ne furent jamais de simples moyens au service des hommes. Avec les objets usuels, ils ont été la part la plus importante des hommes mêmes, s'il est vrai que ceux-ci sont des animaux signés, des mammifères technosémiotiques, ou plus abstraitement des systèmes technosémiosomatiques.
Cependant, les média artisanaux, du moins quand ils s'objectivaient en science, comme ce fut le cas en Europe depuis les Grecs, tendaient à se donner pour de simples causes instrumentales aux mains d'individus pensants, jugés seules causes efficientes. Aristote et Descartes illustrent classiquement cette vue. Au contraire, les média industriels contemporains aident à dissiper l'illusion. Par leur envahissement, ils travaillent moins comme des instruments particuliers que comme des milieux dans lesquels chacun baigne, émetteur et récepteur ; et un milieu n'est pas un moyen. D'autre part, leur spécificité technologique est si forte, et elle dépend tellement de processus scientifiques et gestionnaires planétaires, que leur logique interne devient fatalement celle de leurs éventuels messages, comme aussi de leurs destinateurs et destinataires : "RTL c'est vous". Enfin, ils tissent entre eux un espace-temps orchestral, en un concert où tantôt ils s'entraînent et s'apparient sur une même pente, tantôt par contre aiguisent leur spécificité pour compenser ce qu'il y aurait de déséquilibré dans leur attraction d'ensemble : ainsi, dans la digitalisation générale, le son radio exploite ses caractères pour suranalogiser.
Ce n'est pas tout. Nos média ont encore un caractère cosmologique et cosmogonique qui déplace l'humanisme occidental dans son entier, et que nous allons vérifier également en suivant leur ordre d'apparition.
1. LA PHOTOGRAPHIE ET L'INTRUSION DU RÉEL
Car qu'est-ce que la photographie sinon une catastrophe chimique contrôlée dont l'ensemble germe est l'ensemble des points d'impact des photons dont on veut déceler l'existence?
René Thom, Stabilité structurelle et morphogénèse, Benjamin, Massachusetts, 1972.
C'est la photographie qui la première, autour de 1850, ébranla la position de l'homme à l'égard de ses opérations et de leurs résultats.
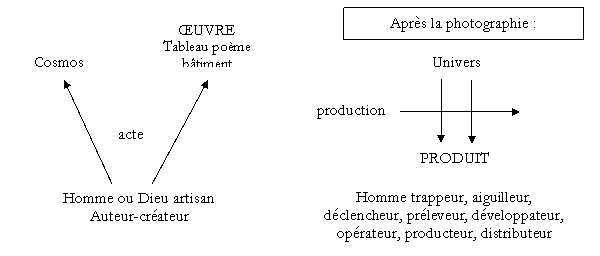 |
La représentation occidentale fut ébranlée du même coup. Jusque-là, selon la définition du vrai comme adéquation au réel, elle essayait de saisir dans les choses une certaine essence au moyen de signes analogiques (dessins) ou digitaux (mots, chiffres). Par la photo elle devient une image au sens physique ou mathématique du terme, une certaine application moyennant une fonction : en l'occurrence la conversion, à travers une optique et une chimie, d'un ensemble de photons réfléchis ou émis en un ensemble suffisamment résolu d'impacts de photons. Cette nouvelle représentation l'homme ne pouvait plus la faire comme auteur-créateur, mais seulement la prélever, la contrôler cybernétiquement. Et les incertitudes représentatives allaient tenir autant aux propriétés ondulatoires et granulaires des ondes électromagnétiques qu'aux défaillances de l'effort humain.
Plus subversivement encore, les résultats ne se donneraient plus comme étant d'abord des représentations. C'était initialement des impacts de photons témoignant d'arrivées de photons, bref des événement bourrés de leçons physiques, chimiques, cosmologiques et qui n'étaient représentatifs que de surcroît, un peu comme l'image d'une montagne dans un lac. Techniquement la photographie était un piège à lumières et à images physico-chimiques et mathématiques de lumières (ce qu'aperçut tout de suite Arago ) avant d'être un piège à représentations instructives ou émouvantes (ce que poursuivirent humanistement ses premiers inventeurs). Rappelons-nous que c'est Herschel, un astronome, qui lui donne son nom définitif : photographie, remplaçant photogénie, de Talbot. Assurément, la photographie peut capter à la fois une étoile ou mon voisin, mais elle saisit la bague de mon voisin comme une étoile, tandis que la peinture ancienne signifiait une étoile comme la bague de mon voisin. Pour la première fois, un médium cosmologise avant de signifier, ou même d'indiquer ou d'indexer.
La chose était d'autant plus saisissante que la photographie proposait ce qu'on pourrait appeler une cosmologie dure, c'est-à-dire mettant en relief les aspects les plus déroutants de l'univers. L'homme classique aussi faisait parfois une cosmologie à travers ses oeuvres de représentation. Mais c'était celle dont la matière était l'eau, l'air, le feu, la terre, éléments artisanaux encore proches du corps humain ; la lumière semblait immatérielle ou d'une matérialité paradoxale. La lumière que pratique le photographe c'est les ondes électromagnétiques, dont chacun sait que la vie dépasse les milliards d'années, et les distances parcourues les milliards d'années-lumière. Et cela avec des propriétés quantiques de photons qui déroutent radicalement l'idée de représentation comme analogie. L'analogie, représentation proportionnelle, et donc exaltation humaniste du Sens, se donne ici comme le résultat hasardeux d'une multitude de décisions partielles insignifiantes (tel halogénure a viré ou non, O-I). Le microcosme-macrocosme, le cosmos-monde, "oeuvre" de l'acte créateur (sémiotique, volontaire) de Dieu et de l'homme co-créateur, fait place à l'univers, avec ses remontées locales et transitoires d'ordres parmi des ruissellements généraux de désordres. Les signes, oeuvres humaines (et divines) par excellence, sont remplacés par des empreintes éventuellement indicielles, éventuellement indexées, faisant apparaître toute réalité (le réel apprivoisé par les signes) comme submergée et transie de réel (le réel comme échappant au confort des signes). Indiciologie et indexologie plus que sémiologie. En particulier, où mettre l'objet et le sujet, maintenant que de la perspective à double centrage (de l'objet, du sujet) de la représentation occidentale il ne demeure qu'une topologie, où du reste le devant-derrière, le dedans-dehors, le loin-près sont peu décidables ? En d'autres mots, les média anciens, quand ils proposaient une cosmologie, la sentaient proche encore de leurs cosmogonies, c'est-à-dire de ces mythes d'origine où l'univers naît, vit et meurt comme nos propres corps, organique comme eux. La photographie décorporéisait, désorganicisait.
Et sans doute aucun autre médium ne le fera aussi cruellement, aussi froidement, dans le concert des média, ni la bande dessinée, ni le cinéma, ni la radio, ni la télévision. Yosemite, vu à travers l'échelonnement photographique de la lumière (the range of light) en reste sans doute le test le plus paniquant (provoquant à cause de cela les adhésions et les répulsions les plus vives), parce qu'Ansel Adams laisse parler l'électromagnétisme, cosmologique, sur un morceau de terre très pur, cosmogonique. Mais il suffit de feuilleter au hasard les photos retenues par les histoires de la photographie (Cameron, Stieglitz, Weston, Lange, Avedon, Hiro, Frank, etc.) ou qui captivent notre attention aujourd'hui (Trivier, Radisic, Duck, etc.) ou qui font la grande publicité internationale (Helmut Newton, Love Me Tender) pour se rendre compte que nulle part ne se posent aussi obstinément des questions aussi radicales, aussi cosmologiquement philosophiques.
La photographie humaniste, ou tout simplement psychosociologique, s'essaye généralement à estomper cette spécificité du médium avec ses déroutes, en privilégiant l'émotion et la présence (vivante, dit-elle) de l'indicié, en indexant ce dernier de manière à le faire passer pour un réfèrent (comme dans une représentation par signes), voire un réfèrent sans code (c'est bien lui). Mais même alors, le médium, la photographie, insiste. Cela peut faire des coïncidences entre médium et intention, comme dans les "Visages d'amour" d'Holger, où les carnations virent en même temps que la pellicule vire. Ou dans "Elle s'appelait Madame Thérèse", où Francine Vanberg profite du côté de flaque erratique de l'empreinte lumineuse pour reconstruire sa mère morte (dont elle ignorait l'ivrognerie, révélée par la cirrhose finale, et qu'elle n'avait donc pas connue) à travers les photographies, les flaques photoniques, de corps féminins âgés saisis justement comme des rassemblements de courants liquides troubles traversant indifféremment des corps multiples : photo-biographie dans sa pleine cohérence. Encore le grand écart entre la déshumanisation cosmologique du rnedium et l'humanisme du thème peut-il avoir aussi sa fascination. C'est la leçon de la photographie méditerranéenne (inverse à cet égard de la californienne), celle de Boubat ou de Nori.
L'insistance cosmologique du médium devait déplacer du même coup l'œuvre et son maître (le maître d'œuvre et le maître de l'œuvre) vers l'opération et l'opérateur. Les mots se bricolent au fil des siècles. Le même verbe latin "operari" a donné "œuvre", de formation vulgaire, et le couple "opérateur-opération", de formation savante. Or œuvre, de vieille souche, est resté très théologique, très lié à l'idéal de création divine ou humaine, de substance à substance, de forme à matière (operari sequitur esse, dit le moyen âge) ; d'où l'opus musical, les "œuvres complètes" dont parlait Goethe, l'œuvre comme totalité au masculin singulier : pour un pianiste les Kreisleriana de Schumann sont une œuvre et peut-être son œuvre dans ce sens très fort. Par contre, le couple opération-opérateur s'est mis à désigner les passages et les agents de passage, comme l'opérateur cinéma, ou les instruments de transformation en informatique et en mathématique, dans des cas où il y a justement peu ou pas d'œuvres, mais des prélèvements.
C'est du côté du couple opération-opérateur que bascule le processus cosmologisant qu'est la photographie, et après elle tous les autres média contemporains. Elle ne construit pas, elle ne compose pas au sens fort (sinon du côté de l'empreint, dans le stage photography). Elle prélève (coupe - agrandit), elle compatibilise - comptabilise - computabilise des événements extérieurs, des actions et réactions photoniques, des dispositifs expérimentaux, des physiologies cérébrales avec leurs schèmes sémiotiques, indiciels, indexants qui les travaillent selon leurs anticipations-rétroactions et leurs pluricentrations-mémoires. Et cela dans le glissement incessant d'autres cadrages et tirages proliférant dans le genre d'historicité qu'on attribue actuellement à tout. Relais de relais pour les relais et interfaces que nous sommes, et que le tout est lui-même. Le contraire du monument ou de l'inscription en éternité (exegi monumentum perenne). On a parlé d'œuvre ouverte ; c'était sans doute une façon d'annoncer qu'il n'y avait plus d'œuvre du tout, au sens de l'ergon grec qu'Aristote mettait si bien entre le ponos et la praxis. Il ne faut pas confondre la production de tirages et de montages, si intenses soient-ils, avec la production d'une œuvre, car ce serait se tromper de cosmologie et, la bande dessinée nous le dira, de cosmogonie. Le microcosme du macrocosme faisait des œuvres au sens plein. Notre univers n'en fait pas. Il serait suspect que nous, états-moments d'univers, nous croyions trop en faire.
2. LA BANDE DESSINÉE ET LA TOPOLOGIE NAÏVE
J'ai tout de suite l'image avec les chevrons Citroën. II fallait que je trouve l'histoire qui y mène.
Moebius, Spirou, 20-12-84
La bande dessinée, qui produit sa divine comédie avec McCay au lendemain de 1900, partage la radicalité de la photographie.
Sa spécificité tient dans la multiplication de cadres saisis successivement et simultanément (anticipativement et rétroactivement) sur une page simple ou double. Ce dispositif très particulier entraîne la plume ou le crayon qui s'y aventurent, car c'est un dessin, à déclencher en tous sens les transformations élémentaires, machiniques et somatiques. D'abord les modifications de taille et de volume du Même. Puis les multiplications du Même, variées ou identiques (les Dupont et les chevrons Citroën). Puis, les passages du Même à l'Autre, catastrophes (changements de forme), voire chréodes (suites cohérentes de catastrophes). Donc ce qui importe ce ne sont plus les égalités transponibles de la géométrie classique (et par conséquent les proportions de la figure ou de la perspective classique) mais seulement les rapports de voisinage et les classes d'homéomorphismes et allomorphismes de la géométrie contemporaine, la topologie.
Jusqu'où peut-on varier, devenir plus grand ou plus petit, plus rond ou plus carré, s'apparenter à l'arbre ou à la bête, être à la fois ectoderme et endoderme, tête en bas et tête en l'air, habitant ou habité, tout en demeurant le même ; mieux, identifiable ; mieux, reconnaissable ; mieux encore, simplement repérable, sinon comme individu, du moins comme type ? Quand le processus est-il tel qu'on varie à l'intérieur d'un type ou qu'on passe d'un type à un autre ? Quand y a-t-il catastrophe ? C'est la question permanente de l'animal signé, dès lors qu'il naît, croît, se développe, se confond, engendre, se ride, rétrécit, de 7 à 77 ans, dit pertinemment le slogan de Tintin. Et cela vaut autant pour l'environnement qu'il est : la trappe qui s'ouvre, la porte qui se rabat, la proie qu'on ingère et qu'on digère, la corde ou le rocher qui cède, l'aspérité qui retient au bord du précipice, et en général, depuis Major Fatal, tous les engrènements de machines.
On conçoit bien alors que, parmi ces rapports topologiques, on insiste sur le plus riche, celui où le cerveau humain (et déjà animal) exerce sa faculté la plus féconde, celle de "confondre" les variables externes et internes d'un système (dont le corps propre) avec les variables internes et externes (donc en ordre inverse) du système coapté. Rappelons que c'est le cas de la chasse à relais, du dépècement, de la nidification, de l'accouplement. L'histoire d'O de Crepax comme la houle de l'Atlantique de Fred sont consanguines à la bande dessinée parce que ce sont des pratiques extrêmes du dedans-dehors. S'appeler Moebius c'est s'identifier au genre B.D. lui-même : la bande dessinée (comic strip) a toujours circulé sur le rouleau moebien (Moebius strip), figure topologique par excellence. "Comics" marque alors l'identité d'une certaine terreur et d'un certain rire, qu'osent pleinement les enfants, dans le corps non du plaisir mais de la jouissance, et où les transformations ultimes du corps et du bureau de Lagaffe sont un cancer, précisent les Idées noires de Franquin, dont les pages de garde portent la dérive de l'univers.
En même temps que s'activent les rapports topologiques des processus et des système saisis, s'opère le feuilletage logique de leurs modes de saisie : le sérieux, la rêverie, le jeu l'exploration, le bluff (dominance), la minauderie (soumission), qu'a déployé Schulz. A ce point de vue également, le crayon du dessinateur, dès qu'il s'engage dans ces cadres de cadres, est pris dans des sauts, des collisions, des doubles pentes. La B.D. c'est bien des cadres imageants, non des images encadrées.
Quand il intervient, le langage est entraîné dans ces dérapages et ces mises à nu. Inscrit dans des bulles, elles aussi imageantes et imagées, et en tout cas creusant d'autres cadres dans les cadres, il étale là l'indépendance de ses trois articulations, phonématique, sémantique, syntaxique, qui du coup d'embrouillent, se boursouflent, s'évanouissent d'autant plus que se fait jour leur double nature, digitale et analogique, avec à nouveau tous les modes de saisie (sérieux...). Schulz et le Hergé de Quick et Flupke offrent un recueil complet des paradoxes logiques. Qu'y-a-t-il d'étrange à exposer, sous le titre "Bruxelles la nuit", des tableaux tout noirs dans des cadres variés, se demandent les deux gamins (précisément à l'âge des paradoxes logiques), qui en si bon train vont afficher "Il est strictement défendu d'affiché", écrit en capitales à la main et avec une faute d'orthographe, sous l'inscription "Défense d'affi/sous peine d'ame", écrite en capitales et croit-on sans faute d'orthographe. Les croisements de modes sont indéfinis :
| impératif | indicatif | |
| impératif direct | impératif réflexif | |
| impératif simple | impératif renforcé (strictement) | |
| imprimé | écrit | |
| orthographié | non orthographié | |
| officiel | privé | |
| général | particulier | |
| venant avant | venant après | |
| sérieux | jeu + bluff. |
Ces couples tantôt se renforcent, tantôt s'annulent, tantôt font les deux à la fois, se croisent : défense-jeu et défense-provocation sont plus sévères ("strictement") que la défense sérieuse, etc. Sans compter que l'exécuteur de l'édit en amont (l'agent de quartier) est amené à prendre connaissance de l'édit en aval, tandis que l'animalité du chien attentive au chant de Quick et à la marche alerte des deux forbans ouvre un cycle d'actions échappant à la loi et à ses procédures, dans la présence du tramway, candide par sa ferraille mais légal à son tour par son nom très digital (1262) et surtout par son numéro de programme, le plus plein des chiffres : 4. Etc.
La narration romanesque est alors remplacée par le scénario, lequel n'a pas pour fonction de créer un engendrement d'existence, mais exactement de faire en sorte que les catastrophes et chréodes imagétiques et linguistiques ne s'entredétruisent pas trop, qu'elles s'orchestrent même par moments. Cela est surtout vrai quand le projet est plus ambitieux, et qu'on se propose de s'insinuer dans la topologie et la sémiologie de civilisations entières, comme font Hergé ou Pratt. Il faut un thème, généralement initiatique, très différent de l'intrigue ou du cours romanesque. C'est bien d'initiation qu'il s'agit quand on affronte la topologie et la sémantique fondamentales, et on comprend la ferveur enfantine et adolescente pour cet art.
Le rapport aux photos est patent. Somme toute, la bande dessinée était techniquement possible dès 1500, dès l'invention de l'imprimerie. Il a fallu sans doute la réinterprétation topologique de la représentation introduite par la photographie pour que la B.D. ose exister et devienne un genre nécessaire et prodigieusement diffusé. De part et d'autre se multiplient les cadres et les recadrages sur une même page ou à travers les pages, dans le feuillettement propre au magazine. Les zooms. Les plongées et contreplongées (avec lesquelles conspirent curieusement les buildings de Chicago de 1890). Les prélèvements (découpes et blow up). Les piqués et tramés. Les bobines et les bandes (strips). L'ambiguïté des modes de saisie, par leur prolifération dans la B.D., par leur aplatissement dans la photographie. Et partout les monstres : encore un de ces monstres ridicules, dit Moebius, un de ces monstres merveilleux, croquent Avedon ou Radisic.
Et dans cette libération réciproque de la bande dessinée et de la photographie, le sujet se dissout. Mc Cay appelle son héros le petit personne, Little Nemo. Et il le situe avec autant de bonheur in Slumberland, ce pays du sommeil paradoxal que Freud explore concomitamment, selon la même topologie, dans sa Traumdeutung. Ici encore la rêverie le cède au rêve.
Assurément, ne travaillant pas sur un agent universel, comme les ondes électromagnétiques, la bande dessinée ne saurait être cosmologique, comme la photographie. Etant un dessin, elle procède du rythme et de la chaleur d'une main humaine. Radicale, activant la topologie la plus primitive, elle sera donc cosmogonique, tout comme la science-fiction, qui sort aussi d'une main, et qui sous-tend ses scénarios les plus forts. C'est ce que montrent Wuzz de Druillet ou Idyl de Jones (l'idyle, la petite forme, c'est bien ce qui topologiquement peut être à la fois l'arbre, la bête et la femme, dans le partage non encore effectué des éléments). Moebius est notre Hésiode, pense Fellini. La B.D. ou le fond du fond, pourrait-on titrer (Moebius titre : "Vers le fond"). Un fond qui, à en juger par le "Transperce-neige", est plus froid que chaud. Mais le fond de l'univers, en débit des étoiles à neutrons et des trous noirs, n'est généralement pas très chaud. La cosmogonie de la B.D. est dure, comme la cosmologie de la photo est dure. Nous disions bien qu'elles sont parentes.
3. LE CINÉMA, LA TOPOLOGIE DIFFÉRENTIELLE ET L'HOMINISATION
La Recherche du temps perdu c'est une femme qui part tout le temps... un homme la suit... quand il la rejoint il ne sait qu'en faire... puis elle repart.
Schlöndorf à Antenne 2
L'éclosion du cinéma est à peine postérieure à celle de la bande dessinée. Apparemment, il ne fait qu'ajouter à la photographie déjà existante un déroulement des images photoniques à une vitesse qui excède la capacité d'échelonnement de l'œil. Mais ce déroulement continu bouleverse tout, et fait que la production la plus philosophique qui soit, la photographie, devienne la moins philosophique, le cinéma.
Celui-ci propose à son spectateur des lumières mobiles bidimensionnelles mais tridimensionnantes, et pour autant lestées de poids, réfléchies sur un écran moyen ou grand. Ce ne sont donc pas seulement des mouvements mais des mouvances, selon la bonne fortune du français, qui parle de mouvances actives et passives. Il faut prendre en compte la capacité d'attraction de mouvances semblables sur les mammifères de notre espèce : au cinéma nous sommes d'abord des chiens, des chats, des singes des savanes, aspirés par des masses qui bougent. A la cinématique s'ajoute une dynamique, la topologie est différentielle. Dans ce genre de chasse, nous savons aussi que la proie attire d'autant plus qu'elle est appréhendée discontinûment dans l'espace et dans le temps : le plan devient la séquence de plans, laquelle n'a même pas à être toujours catastrophique ou chréodique pour créer un premier suspens.
Cependant, à la différence de l'animal qui se précipite sur les mouvants lumineux quand ils sont à son gabarit, nous restons assis dans nos fauteuils. C'est que notre saisie (et notre mimèse) n'est pas seulement frontale comme celle de l'animal, mais aussi transversale, comme il convient au singe vraiment debout, selon le plan de nos deux mains plates, à douze dimensions, mais planéifiantes, symétrisantes, substitutives-comparantes, indicielles, et pour autant possibilisatrices ; au cinéma, notre suspens de chasse est en même temps suspens de possibilisation. Cette dernière y est du reste activée par le contraste entre le référentiel stable des quatre angles droits de l'écran et la mollesse de la lumière réfléchie, où les êtres sont bien des stars, des lueurs lointaines d'étoiles (il n'y a pas de stars sous les feux de la rampe théâtrale).
Peut naître enfin le troisième suspens, sémiotique. Car, dans ces mouvances photoniques quadrangulaires, où la possibilisation glisse à la convention, le signe paraît sans être jamais crûment donné, il est toujours en train de (re)naître de ses soubassements et y retourne. C'est au cinéma que se manifeste le mieux le développement par lequel, d'instrument qu'il est chez l'animal, le bâton devient indice (outil), puis index (signe sacré à référent indéterminé), puis signe (sceptre analogique, enfin digitalisé dans le discours des scribes), en un cycle qui est l'hominisation, bien figuré par Kubrik au début de 2001 Odyssée de l'espace, et qu'on retrouve travaillant les objets usuels et en général l'environnement chez tous les cinéastes.
On le voit, ce n'est pas la théorie générale de l'hominisation qui éclaire le cinéma. C'est le cinéma qui, combinant ostensiblement l'attraction irrésistible de ses mouvances photoniques avec la distanciation possibilisatrice de sa transversalité (aidée de sa lumière réfléchie), crée le dispositif expérimental le plus frappant pour saisir, dans leur recommencement perpétuel, les stades de l'hominisation. L'hominisation qui a eu lieu aux origines, dans la Guerre du feu. Celle qui se refait en nous à chaque éclair de pensée. Celle qui envisage l'Autre (possible) l'Alien, dans une possibilisation catastrophique et chréodique cette fois.
Ce qui est cinématographiquement perçu, ce qui reste dans la mémoire à terme court, moyen ou long des cinéphiles, c'est des bouts du triple suspens de topologie différentielle, de possibilisation indicielle, d'indexation et sémiotisation allusives, à quoi nous suffisent une montée ou descente d'escalier, une randonnée, un repas silencieux, un habillage ou déshabillage, une fusillade, une altercation, un accouplement, lesquels remplissent les neuf-dixièmes des films, sans que nous cherchions à en savoir les mobiles exacts.
Aussi, la narration fait place au scénario (comme dans la bande dessinée), car les mouvances possibilisées ont trop d'emprise sur nous, singes des savanes, mammifères technosémiotiques, pour que nous puissions y suivre une vraie histoire, un roman à intrigue ou à thèse. Il y faut les thèmes à tiroirs des Aventurieurs de l'arche perdue, des Kung Fu, des séries X, et en général des films comiques. Les thèmes à stéréotypes reconnaissantes des westerns ou des épopées de Griffith, d'Eisenstein ou de Jancso. Les tableaux felliniens de Roma et Casanova, où bouillonnent l'indiciologie et l'indexologie des grandes nations européennes. Les simples parcours d'autos et les motos de Easy Rider (tout cinéphile est un easy rider). Les turbulences mystiques de l'Exorciste. Les symboles et mythes d'origine de E.T. et des Starwars. Enfin, à la limite, le pur déroulement accéléré et décéléré de Koyaanisqatsi. Chaque fois, le rythme intraséquentiel l'emporte sur le rythme interséquentiel, c'est lui qui fait le sujet cinématographique.
Jusque dans les films les plus cérébraux, le thème est peu cernable, quelles que soient les précautions du réalisateur et la qualité du public. Il y a des scénarios qui sortent de roman, et des romans qui invitent au scénario, mais il est sans doute redoutable de professer qu'un scénario est un roman dont on a mis les actions dans une colonne de gauche et les paroles dans une colonne de droite. Le roman est le genre qui s'alimente à la croyance en l'historicité (plus ou moins dialectique) de l'existence humaine. Le cinéma vit de mouvances qui déjouent l'historicité, et ne peuvent qu'être montées. Le thème d'un film est proposé par un synopsis, joli mot qui dit bien qu'il s'agit d'intuitionner une mouvance globale riche de mouvances particulières à monter, non de l'engendrement temporel que le roman ancien a poursuivi dans l'intrigue, et le nouveau roman dans le cours, dont le plus puissant reste celui de la Route des Flandres.
Quant à la mise en évidence du médium, le cinéma est l'inverse de la photographie. Comme elle, il est le résultat d'une image au sens physique et mathématique. Mais ce fait, souligné par la fixité des photos, il le volatilise dans ses mouvances. Dès lors, autant la photographie dissout la réalité dans le réel, autant le cinéma dissout le réel dans la réalité. Il est, comme le dit parfaitement le français, une réalisation, produit d'un réalisateur, malgré le rôle indispensable des producteurs, scénaristes, directeurs de la photographie, cadreurs, monteurs, mixeurs. Il est si réalisant que les conduites orgastiques y sont spontanément sexuelles, et qu'il y faut des artifices de mise en scène ("mise en scène" s'oppose à "réalisation") pour les rendre érotiques, pornographiques, obscènes ou perverses. Distrayant de son caractère électromagnétique, le cinéma ne saurait être cosmologique, comme la photographie ; mais ses pouvoirs de réalisation joints à sa mise en évidence de l'hominisation en ont fait le lieu privilégié de nos cosmogonies, et de nos "rencontres du troisième type", concomitamment avec la bande dessinée (Moebius se dit un consommateur boulimique de films de toutes sortes).
C'est sans doute aussi cette pente réalisatrice qui a fait que les cinéastes ont relativement peu exploité les prises de vues troublantes (à ne pas confondre avec les effets spéciaux, justement réalisants), et que les virtuosités d'Abel Gance sont restées sans lendemain. De même les tentatives de faire des films réflexifs ou critiques. Réalisateur, le cinéma est naif, qu'il vise à être quotidien ou extrême. Assurément, il peut thématiser les aspects de sa réalisation : Vertigo montre l'écran comme pompe aspirante quadrangulaire, Rear Window comme fenêtre de fenêtres parmi des fenêtres, et la caméra comme détective estropié, etc. Mais cela déjà échappe largement au spectateur, entraîné dans les mimèses frontales et transversales des mouvances photoniques. Il est curieux que Hitchcock se soit plaint d'être mal compris, dans une démarche qui n'est pas faite pour être comprise, mais prise, possiblement.
Pour autant, le cinéma forme avec la photographie un cas remarquable de concert des média. Depuis 1900 environ, il a dispensé le photographe de pourvoir le public de réalité, sauf dans la pseudo-réalité des souvenirs, et l'a autorisé socialement à s'adonner au réel (voire au surréalisme), et cela jusque dans la grande publicité internationale de parfums, de vêtements, de cigarettes, de voitures. Inversement, la photographie, pourvoyeuse de réel par sa trame électromagnétique, a dispensé le cinéaste des soucis trop radicaux et lui a permis de se livrer sans scrupule à sa verve réalisatrice, que ses thèmes soient quotidiens ou cosmogoniques, que ses effets soient naturels ou spéciaux. Spielberg et Lucas peuvent d'autant mieux s'en donner à coeur joie qu'ils ont à leur côté Avedon ou Cheyco Leidmann.
Ceci ne nous fait pas oublier India Song ou Sauve qui peut la vie, où la réalité est minée par la trame de réel. Mais justement, dans ces cas, le film se tient dans un certain en-deçà photographique du cinématographique. C'est le même en-deçà qui, pour certains, fait la séduction des films primitifs à seize images seconde, où l'aspiration irrésistible des mouvances était neutralisée par le décochement encore sensible des photogrammes successifs.
4. LA RADIO ET LA GALAXIE SONORE
Vous avez toujours une goutte de lait qui vous couie au bout du nez.
Un étudiant de cinéma à des étudiants de radio.
La radio commence à envahir l'environnement autour de 1930. Nulle part on ne voit mieux comment un médium, sauf dictature puissante, a une logique interne qui s'impose à tous ses produits.
Au début, les ondes hertziennes diffusèrent les musiques, les voix, les langages du monde antérieur : simple moyen de multiplication industrielle d'une culture se croyant encore artisanale. Mais bientôt le son radio fit sentir qu'il avait une texture et une structure propres. En effet, il se prête mal aux contrastes dynamiques de la musique classique (de la symphonie à la valse), et suppose une continuité de l'intensité qu'on peut appeler plaisamment continuité du décibel. Il répugne aux sauts mélodiques et timbraux, et donc en général aux prélèvements trop nets de l'information sur le bruit. Il supporte aussi peu les commencements que les fins, voire les initiatives incessantes (Mozart), tandis qu'il se plaît aux processus stables et même autogénérés, répétitifs (Reich, Glass), à l'information en émergence et en immersion dans le bruit de fond, à la mélodie et au timbre "dauphin" (des radios locales ont pris le dauphin pour sigle). Sa dimension de développement est celle des couches multiples de son mixage.
On aura reconnu les propriétés mises en système par le disco. Le disco est la musique véhiculaire du son radio. Et, comme il était normal, cette musique a communiqué ses caractères à la pose de voix de ses présentateurs et présentatrices, puis à la phonématique, leur sémantique, leur syntaxe, enfin à tous les intervenants de la radio jusqu'aux hommes politiques. Furent favorisés les accents régionaux et les langues anglo-saxonnes (surtout dans leur interprétation afrocubaine), où le bruitage, la fluidité des accents, le non-prélèvement sur l'environnement s'annonçaient antérieurement.
Ainsi, le son radio n'est pas cosmologique en ce qu'il thématiserait, comme la photographie, les ondes électromagnétiques -peu d'auditeurs sont sensibles au fait qu'ils reçoivent des ondes hertziennes- mais il l'est par un autre biais, en proposant une saisie thermodynamique de tout ce qu'il charrie, brassant sans cesse des fluences globales avec des stabilités transitoires, des couples tendus de probabilités et d'improbabilités, d'entropie et de néguentropie, d'information et de redondances fécondatrices, c'est-à-dire ce qui nous paraît comme les agents secrets, ultimes et quotidiens, de l'univers et de la simple existence.
Il a pour autant une vérité déconcertante. La musique classique était sublime, mais c'était un sublime mensonge, le moyen le plus puissant jamais inventé pour faire croire à des êtres périssables que l'information est traitable à l'écart du bruit, et que nous sommes chacun capables d'être le sujet de cette information, monarchiquement, à la fine pointe sismographique du bâton d'orchestre, où culmine Prova d'orchestra. Le son radio maintient que la musique, intimement digitale et analogique, est l'expérience du pur exister, mais il propose à ce dernier comme les cosmologistes contemporains, c'est-à-dire comme les entrelacements et les fécondations réciproques de l'information, du bruit et de l'énergie, où les (re)gradations locales ne vont jamais sans dégradations ambiantes au moins équivalentes.
Il met d'ailleurs en relief, dans la même veine, un autre aspect de la thermodynamique cosmologique, c'est qu'un même moment du temps, dans le même système, peut être habité de régimes différents et même contradictoires. Pour prendre un exemple cher à Reeves, dans une fécondation humaine, le combat sans merci des spermatozoïdes pour s'obtenir la pénétration d'un ovule est (largement) indépendant du calme qui règne en-dessous d'eux, vers le travail chimique des molécules, atomes, nucléons et quarks, et de la volupté qui règne au-dessus, laquelle peut à son tour contraster avec des fins intéressées, voire agressives, plus loin encore. Le Même est autre non seulement avec les vrais autres, ou avec lui-même successivement, mais avec lui-même synchroniquement. Ces différences simultanées de régimes, qui jouent partout dans nos cosmologies, le son radio, avec ses pistes multiples, les donne à sentir et à pratiquer comme aucun autre médium ne peut le faire -la musique classique ne s'y risquait que dialectiquement, c'est-à-dire en les niant.
Cela lui a valu de surcroît une vocation architecturale. Pour le comprendre rappelons quelques évidences physiologiques. Le mammifère signé, qui a passé neuf mois dans une matrice, garde pendant toute son existence, comme les autres mammifères, le désir et le besoin d'un enveloppement en toutes directions. Cette fonction d'enveloppement spatial et temporel a traditionnellement été remplie par l'architecture (ou la tente du nomade), dont on comprend ainsi la récurrence des motifs : il faut que, regardant dans un sens, je continue à savoir à peu près ce qui se passe dans les autres. Or l'architecture contemporaine est devenue indapte à assurer cette fonction vitale pour divers motifs : la rupture des systèmes de valeurs collectifs supposés par les projets urbains et ruraux cohérents ; la disparate des séries industrielles du bâtiment ; la construction conçue moins par édification que par prélèvement dans des processus de soi indéfinis ; la prévisibilité (donc l'insignifiance) des ensembles planifiés, même quand on y applique une combinatoire virtuose. Dans cette situation, seule excelle l'architecture des lieux de passages, celle des complexes commerciaux couverts et des halls d'expositions, qui contrastent, par leur vitalité, avec la banalité de la demeure et du lieu de travail.
Le son radio est capable de remédier à cette déficience. Dans les lieux d'habitation les plus déshérités, il suffit d'introduire une radio portative bon marché pour que l'enveloppement soit retrouvé ; le son aussi entoure de toutes parts, devant-derrière, dessus-dessous, gauche-droite. Il peut même masser kinesthésiquement, cénesthésiquement, atteignant notre cerveau dans son tréfonds à la fois analogique et digital. La radio, couplée avec les éclairages à sources multiples, et branchant le téléphone sur l'antenne, est l'architecture de ceux qui n'en ont plus : "Vivez en Europe I". En retour, sa fonction utérine confirme le son radio dans sa texture et sa structure disco, qu'il s'agisse de musique ou de langage. Les micros préleveurs livrent l'intimité du corps du locuteur en son souffle. Même les journaux parlés, destinés à être moins écoutés qu'entendus, et souvent nourris de la présence physique du conteur, contribuent à cette opération phatique (thématisant le canal, non le référent) : je suis là, tu es là, vous êtes et nous ne sommes pas seuls. C'est sans doute pourquoi les nouvelles radiophoniques sont peu troublées quand on les interrompt par l'opéra publicitaire : "Et voici quelques pages en couleur". Pourquoi aussi les messages les plus forts (L'Afrique affamée n'a pas besoin d'argent mais de compétences) passent le mieux quand ils ne sont pas énoncés dans le discours frontal d'un journal, mais comme un élément erratique d'une émission polyphonique venant de Tombouctou. Le son radio est non vectoriel.
Et il y a une seconde fonction radiophonique aussi nécessaire que l'architecturale : celle de compenser la digitalisation ambiante excessive due à l'ordinateur, à la télévision, à la photographie, vu que l'approche analogique et anexacte reste la première pour les computers hybrides et peu programmés que sont nos cerveaux. Le son radio est providentiel à cet égard. Ses analogies sont assez envahissantes pour estomper l'éventuelle digitalité de ses enregistrements, et même, dans la break-dance, pour lui permettre d'obtenir des continuités accrues à partir du discontinu exalté (selon le principe du swing).
Cette double fonction mammifère s'harmonise assez avec ce que nous avons vu d'abord de la cosmologie douce (thermodynamique) du son radio, contrastant avec la cosmologie dure de la photographie et la cosmogonie dure de la bande dessinée. Les "nuits magnétiques", d'abord nocturnes et de plus en plus souvent diurnes, sont galactiques, pas seulement parce qu'elles émettent à des années-lumière, mais parce qu'elles sont immenses et laiteuses, physiquement et sémiotiquement. Pour des mammifères souvent prétentieux et toujours vulnérables, il n'est pas mauvais que, dans le concert des média, en même temps que l'univers visible de la photo et de la B.D., discontinu, il y ait la continuité compensatoire de la Galaxie sonore. Le cinéma a très vite compris ce qu'il pouvait tirer de tout ceci au profit de ses mouvances cosmogoniques douces, en séquences de plans à la fois discontinues et continues. Sa musique a préfiguré plusieurs caractéristiques du son disco, et il n'est pas étonnant que ce soit dans les lumières réfléchies d'un film que celui-ci ait fait son irruption triomphale sur les jambes disco de Travolta.
5. LA TÉLÉVISION ET L'IRRIDIATION FROIDE
La télévision améliorée ne serait plus la télévision.
McLuhan
II fut un temps où je ne savais pas que j'étais une télévision.
Olivia Clavel, Matcho Girl, 1980.
Il y a deux formes de la télé : celle où la lumière émise est directement perçue par le spectateur ; celle où cette lumière se réfléchit sur un écran. La seconde est plus proche de certaines conditions du cinéma. Nous insisterons sur la première, parce qu'elle est de loin la plus répandue, même aux U.S.A. Mais surtout elle est la plus originale.
Car l'originalité de la télévision tient justement dans sa lumière émise partant d'un petit écran par activation de photogènes. Ainsi est-elle du domaine de l'énergie avant d'appartenir à celui de l'information, et sa couleur clinquante, peu différenciée par les signaux électromagnétiques, ainsi que ses fluctuations fréquentes de régime, confirment ce caractère. Comme les néons et le fluor, c'est une luminescence, donc une lumière émise froide, qui n'a plus rien de commun avec les lumières émises du monde ancien, celles des étoiles au loin et du feu près de nous. C'est un "feu" froid, ni proche ni lointain, ou ubiquitaire. Ainsi, le poste de TV achève l'architecture réalisée par le son radio (et les éclairages à sources multiples) en dotant les demeures contemporaines d'un âtre par où l'univers fait irruption dans la chambre, mais par où en retour la chambre se dissout dans l'univers. Pour mieux dérouter la scène classique, ces alignements de photogènes se (re) (dé) coupent en incrustation, où toute donnée peut se réverbérer entièrement ou partiellement, se recadrer et se démultiplier dans toutes les dimensions (comme dans la B.D.). La commande à distance, permettant à tout moment de prélever un poste parmi une douzaine d'autres, généralise ce caractère incrusté, dont la digitalité correspond au papillotement de l'écran.
Les informations (spectacles et événements) se proposent alors comme des modulations épisodiques de l'énergie frontalement émise, de l'âtre froid-chaud visuel-tactile par elles recreusé. Cela fait les thèmes TV, dont on voudra bien remarquer au passage qu'ils ne sont pas ceux du cinéma : une éruption de volcan ; une aurore boréale ; la submersion par les vagues du cap Horn ; un comportement simple d'un oiseau, d'un fauve, d'un être humain ; les marionnettes et leurs gestes saccadés, tout comme les déclics de Goldorak ; une migration cyclique de gnous, parce qu'elle est justement cyclique ; le produit industriel, puisqu'il ne reçoit plus la lumière, mais l'émet. Et ces alignements de photogènes émis par un petit écran favorisent autant les jeux combinatoires, également linéaires, des vidéo-games, et les trajectoires de ballons ou de balles de football et tennis. Dallas est un vidéo-game où les situations familiales sont si claires, où les formes et les retours sont si tranchés, que le spectateur est amené à se rappeler et à prévoir les coups à plusieurs séances de distance, dans le temps à la fois mobile et fermé du jeu d'échecs, ou plutôt des musiques répétitives, puisqu'aux échecs il y a un dernier coup.
On voit que, si l'unité de la mouvance cinématographique est la séquence de plans (peu catastrophique et peu chréodique), l'unité de la mouvance télévisuelle est le plan simple porteur d'une catastrophe simple : l'oiseau de l'île de Midway qui ouvre le bec et le referme, la tache qui persiste puis disparaît avec le nouvel Ariel, les jets des épées rayonnantes des combats interplanétaires, le champ contre champ retournant l'action dans les feuilletons combinatoires, le changement de visage final où Reagan est passé maître. C'est vrai que politiquement la TV est un extraordinaire analyseur de visage. Mais non pour détecter le mensonge ou la vérité, plutôt pour mesurer justement une intensité lumineuse, masculine et féminine, où l'éclat des fausses dents d'un candidat peut être aussi télévisuel que sa bonhomie.
Un paradoxe significatif : si le petit écran dégrade souvent des films faits pour le moyen écran (le cinéma traditionnel), il porte souvent très bien ceux qui sont destinés au très grand écran, comme Apocalypse now ou Indiana Jones. C'est que l'image télévisuelle est devenue l'image dominante de notre époque, et que dans ces productions la réalisation cinématographique s'est mise au service d'un espace-temps indéfini, et énergétique avant d'être informationnel. Cela fait en même temps la concordance des images ciné et TV avec le son radio, qui dorénavant les accompagne. Alien est un film historique parce qu'on y trouve la première image disco, une lumière pulsatoire, vibratile, fuyant les écarts, dans une saisie aquatique et lactée, au sein d'un engin Mamma organisé autour du computer Mother dans l'onde généralisée de l'Univers, au fil de l'interrogation topologique fondamentale, à travers le sommeil et la femme, sur le Même et sur l'Autre. Le vidéo-clip, qui sort de là, pratique la même fusion de caractères télévisuels, radiophoniques, cinématographiques, B.D. et photographiques dans nos âtres luminescents.
Pour apprécier pleinement la situation, il faut voir que l'écran TV est encore couplé avec l'ordinateur. C'est sur lui que l'on "voit" la galaxie Sombrero telle que l'informatique l'a construite à partir de renseignements dont la plupart n'ont rien de visuel. C'est là aussi qu'on "voit" des levers et des couchers de soleils et de lunes avec leurs marées concomitantes dans des systèmes stellaires et planétaires fictifs, pour des Jules Verne non romanciers. Par quoi se confirme le caractère digitalisant des rangées de photogènes et des incrustations.
Mais, en même temps, nous y avons insisté, tout cela dans la télévision est toujours immergé ou plutôt submergé par l'énergie de la lumière émise, phénomène premier, où le discontinu se noie d'avance dans le continu, le digital dans l'analogique. Il serait donc forcé de vouloir apparenter le phénomène télévisuel aux cosmologies et cosmogonies dures ou douces auxquelles faisaient songer les autres média. Il semble au contraire les fondre plus ou moins et devenir ainsi un des lieux privilégiés où ils s'influencent. Le plus bel exemple de ce syncrétisme est sans doute le dye transfer, qui n'est nullement un retour de la photographie à l'esprit de la peinture, mais son assimilation à celui de la télévision, avec les ambiguïtés (fécondes) qui viennent d'être indiquées, et qui sont d'autant plus significatives qu'on les retrouve dans la photo couleur, en particulier publicitaire (Love Me Tender), même quand celle-ci n'utilise pas le dye transfer.
Un tableau ne permet pas de nuances, et le lecteur fera donc la part du feu dans le suivant :
|
Cosmologie : Dure électromagnétisme (digital +) PHOTOGRAPHIE Douce thermodynamique (analogie +) RADIO |
TV |
|
Cosmogonie : Dure topologie (digital +) B.D. Douce topologie différentielle (analogie +) CINEMA |
TV |
6. LE BILAN ÉCONOMIQUE DES MÉDIA
EXCEPTE
PEUT-ETRE
UNE CONSTELLATION
Mallarmé, un coup de dés, 1897.
Toute industrie informatisée favorise une économie dont le moment fort n'est plus la production, propre à l'industrie commençante, ni la consommation, propre à l'industrie adolescente, mais la distribution, en une compatibilisation - comptabilité - computabilité pluridimensionnelle de biens, de salaires, de parts de travail, de circulations, etc., avec des équilibres et des fractures spatio-temporels qui concordent assez avec ce que la cosmologie nous apprend de certains aspects de l'univers. Les média industriels illustrent par leur pente d'ensemble et par leurs compensations mutuelles ce distributionnalisme (quantique). Parmi eux, la photographie a été initiatrice : c'est elle qui, dès 1850, introduit un processus où commercialement, et jusque dans la matérialité du produit, règnent la coupe, la recoupe, le blow up, le tramé, le tirage, dissolvant la stabilité de l'oeuvre et du chef-d'oeuvre au profit de relais, d'interfaces, d'opérations et d'opérateurs. Le multicadrage B.D., le mixage radio, la séquentialité cinéma, et surtout l'incrustation TV généralisent ce procédé, avec les attitudes existentielles concomitantes.
En particulier est ainsi modifié le rapport des sens et du Sens. L'analogie dominant le monde ancien postulait pour finir que les sens particuliers soient les parties "intégrantes" d'un Sens global, qui en était la source et l'accomplissement, tandis que la digitalité de l'industrie et des média industriels donne le significatif comme sortant souvent de choix o-i et d'actions flip-flop, c'est-à-dire du très peu signifiant. La part du hasard (ce mot finaliste aristotélicien, qu'il vaudrait mieux éviter) n'augmente pas pour autant. Alors que le monde ancien ne connaît à tout accroissement d'information que deux sources, soit d'autres informations soit des hasards, les nouveaux rapports aperçus entre entropie et néguentropie nous signalent un troisième principe de la thermodynamique, dont nos médias sont une activation ostensible.
Dans tout système isolé, l'énergie se conserve (1er principe), elle se dégrade (2ème principe), elle se regrade localement et transitoirement moyennant dégradation ambiante (3ème principe). Entre sens et Sens, il y a place pour une activation réciproque des non-sens et des sens. Il est intéressant de saisir quelques photos, quelques fragments de TV, de B.D., de cinéma, de radio avec ces principes-là derrière la tête et dans le corps.
Ceci met à mal les genres traditionnels de l'œuvre : épopée, lyrisme, tragédie, comédie, roman, qui découlaient des textures et structures de l'artisanat rationnel grec. Dans le contexte de la cosmologie et de la cosmogonie récentes, ces genres se sont fondus dans un opéra des média, dont l'opéra wagnérien (éminemment cosmogonique) fut précurseur, et dont la publicité est le résultat permanent le plus populaire et souvent le plus explorateur. En retour, les média artisanaux, peinture et littérature, se pénètrent de la mentalité industrielle. Du new image américain à la transavant-garde italienne, de Claude Simon à Marquez, ils sont désormais cosmologiquement et cosmogoniquement traversés. La sculpture a pour ainsi dire disparu depuis que nos corps relèvent d'une saisie moins mécanique que chimique et physiologique, voire thermographique, où excelle justement la TV ; d'une vision moins géométrisante que topologisante, où excelle la B.D. La musique, au contraire, se porte au mieux, du moins si l'on reconnaît que son statut dominant n'est plus la composition (Opus...), mais un flux planétaire de polyphonie radio d'une très haute qualité moyenne. Le théâtre reste le parangon de la "culture", étant le plus artisanal de tous les arts, le plus difficile à cosmologiser, et même à cosmogoniser.
Tout dans la pratique des média artisanaux occidentaux favorisait la conception d'une "conscience", intrication étroite de fonctionnements et de présence(s) censés s'engendrer mutuellement (dialectiquement) dans l'esprit ou dans le moi. En contraste, les média industriels privent la "conscience" des "œuvres" où elle se donnait le sentiment de s'édifier, s'interpréter, s'exprimer, se dialectiser. Au fil de leurs processus indéfinis, ils stimulent des fonctionnements environnementaux et cérébraux purs, d'une part, des présences pures, impassibles, de l'autre. Le film Koyaanisqatsi est sans doute l'expérience la plus nette, pour l'image et le son, de la coupure philosophique fonctionnements-présence(s) suggérée par l'ensemble des opérateurs contemporains, et remplaçant la coupure âme/corps, "conscience"/monde, en-soi/pour-soi du monde artisanal, avec sa liberté responsable.
On dira que Koyaanisqatsi est une utilisation rare d'un médium comme art extrême, subvertissant les codes sociaux, non comme art quotidien, confirmant les codes sociaux. Il vaut mieux observer que, parmi nos média cosmologisants et cosmogonisants, la distinction du quotidien et de l'extrême s'estompe, voire que les tensions entre codes confirmés et codes subvertis deviennent le thème courant de certains média, telles les radios locales, par là souvent initiatrices par rapport aux radios lourdes. Ceci a des conséquences sur le nombre d'artistes. L'art classique et l'art romantique occidental ont donné très peu d'artistes encore supportables (rares peintres, musiciens, écrivains consacrés), parce que le système était tel que l'"œuvre" y était sublime, anodine ou ratée. Croisant art extrême et art quotidien, nos média industriels et nos média artisanaux industrialisés obligent moins à être ou Mozart ou Saliéri.
C'est dire que les média, comme le reste de l'industrie avancée, opèrent actuellement une sélection drastique de l'espèce, à la fois entre les peuples et à l'intérieur des peuples. Depuis toujours, les changements technologiques, en particulier ceux des média, ont provoqué des redistributions géographiques, culturelles, ethniques. Ces changements furent relativement progressifs aussi longtemps que la technique se contenta d'accommoder la nature très localement ; ils se sont faits foudroyants dans une technique qui transforme la planète en une réalité médiane, où nature et artifice sont étroitement tissés. Pour être adapté aux postulats internes de la photographie, de la bande dessinée, de la radio, du cinéma, de la télévision omniprésente et syncrétique, il n'est sans doute plus indifférent de se trouver à tel endroit du globe plutôt qu'à tel autre, d'appartenir à une culture plus psychosociologique ou plus cosmologique et cosmogonique, de parler ou non une langue à accords ou à racines, de mettre sur les mots des accents fixes ou mobiles, de pratiquer une économie productrice, consommatrice ou distributionnelle, de vouloir faire cohabiter fonctionnements et présence(s) dans une "conscience" ou de laisser les premiers à leurs efficacités et inefficacités, et les secondes à leur innocence irresponsable.
Les enjeux économiques et politiques de tout cela sont énormes. Non seulement parce que pour produire et distribuer des média vendables il n'est pas inutile d'en saisir l'esprit. Mais aussi parce que désormais cet esprit pénètre à peu près toute chose planétairement vendable, c'est-à-dire planétairement désirée.
Henri Van Lier
Le concert des média
Colloque de la Sorbonne, 1984